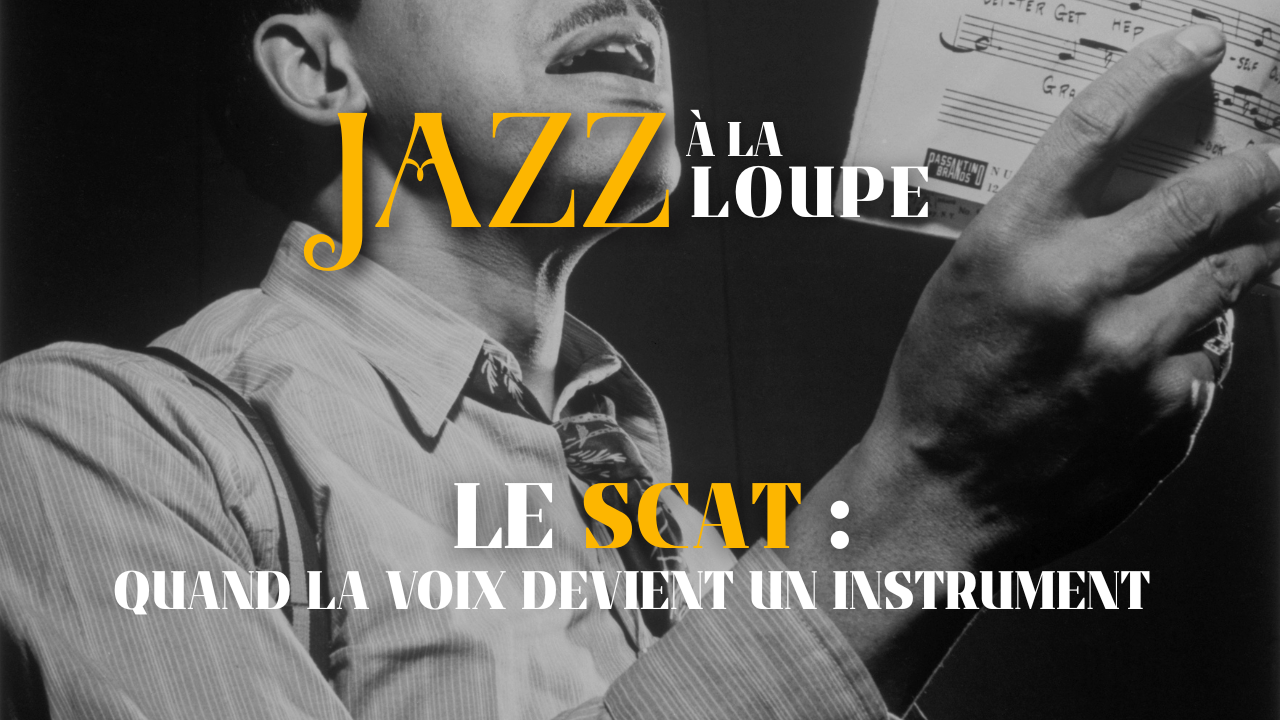Le scat : le terrain de jeu pour la voix dans le jazz
Les amateurs de jazz le reconnaissent à la première écoute. Le scat, c'est cette forme de chant à la fois très ludique et en même temps assez impressionnante, où la voix devient l'actrice principale, et surtout, un instrument à part entière. Sans paroles, sans textes, juste une explosion d'onomatopées, de sons, et bien sûr, de rythmes improvisés. Si les "Scoo-bee-doo-bop", les "doo-wap", ou les "ba-da-bap" donnent l'impression de ne rien vouloir dire, et pourtant, ces sonorités font écho à l'essence même du jazz : la liberté, l'improvisation, et bien sûr, l'émotion brute.
Une naissance accidentelle ?
Selon la légende, l'histoire du scat aurait débuté à cause... d'un joli hasard dans les années 1920. Ce serait une légende du jazz, Louis Armstrong, qui en serait à l'origine. Alors que l'icône est en plein enregistrement de son morceau Heebie Jeebies en 1926, son pupitre, où les paroles de sa chanson étaient posées, aurait basculé en arrière. Mais plutôt que de faire stopper la séance pour récupérer ses paroles, Armstrong aurait préféré continuer à chanter, en improvisant des sons, posant ainsi la toute première pierre du scat. Ce moment historique, qui a d'ailleurs été capturé en studio, marque le début plus ou moins officiel de cette pratique vocale.
Et si Louis Armstrong est très souvent considéré comme le roi du scat, de nombreux artistes ont contribué à faire de cette pratique un art à part entière. Et notamment une, qui a reçu le titre de reine du scat : Ella Fitzgerald. Reconnue pour sa voix hors norme, Ella Fitzgerald était bien plus qu'une chanteuse : c'était une improvisatrice, avec le swing dans le sang. Il faudra attendre une dizaine d'années pour qu'Ella Fitzgerald développe le scat comme son propre langage, enregistrant des morceaux comme "Flying home" (1945), ou "How high the Moon". Avec cette technique, Ella Fitzgerald devient une instrumentiste, devenant elle même son propre instrument.
Une pratique particulièrement exigeante
Si on pourrait croire que le scat n'est qu'une succession d'onomatopées sans réflexion en improvisation totale, détrompez vous. En réalité, il s’agit d’une improvisation maîtrisée, ancrée dans une profonde connaissance de la musique. Le chanteur ou la chanteuse va alors remplacer les paroles par des sons expressifs, jouant avec les rythmes, les notes et les inflexions. Le scat exige une oreille très affûtée, une grande souplesse vocale mais aussi un sens de la mélodie particulièrement développé. Il peut imiter la trompette, la contrebasse, ou simplement créer un contrepoint au reste du groupe.
Parmi les techniques courantes : l’utilisation de syllabes percussives comme ba, do, sho, za, ou dee, parfois répétées en motifs rythmiques ou mélodiques. C’est une conversation improvisée entre la voix et les instruments.
L’influence du scat sur le jazz
Le scat a profondément marqué l’histoire du jazz vocal. Il a offert aux chanteurs une nouvelle forme de liberté, leur permettant de rivaliser d'inventivité et d'improvisation en collaborant avec les instrumentistes. Dans les années 1940 et 50, le bebop, style complexe et rapide, trouve un écho dans le scat, notamment à travers des figures comme Sarah Vaughan, Betty Carter, ou Jon Hendricks, maître du vocalese (du scat avec des paroles ajoutées sur des solos existants.)
Des morceaux comme How High the Moon (Ella Fitzgerald), Moody’s Mood for Love (King Pleasure), ou One Note Samba (Bobby McFerrin) sont autant d’exemples où le scat prend toute sa dimension. Aujourd’hui encore, le scat continue d’inspirer chanteurs et chanteuses de jazz à travers le monde. Des artistes contemporains comme Bobby McFerrin ou Esperanza Spalding intègrent le scat dans leurs performances, montrant que cette forme d’expression vocale, née il y a près d’un siècle, reste d’une modernité éclatante.